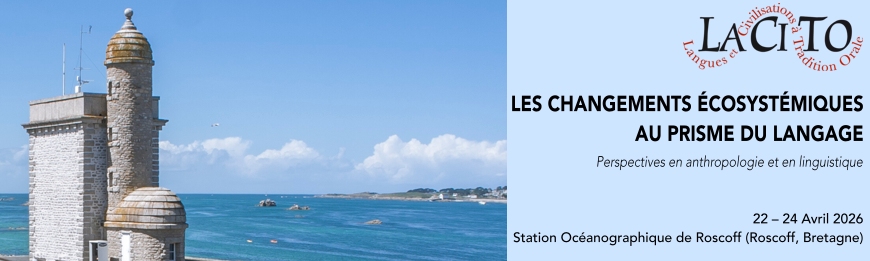
Appel à communicationAppel à communication Les changements écosystémiques au prisme du langage : perspectives en anthropologie et en linguistique Colloque pour les 50 ans du LACITO 22-24 avril 2026
Les changements écosystémiques d’origine anthropique ont un impact sur de nombreuses sociétés qui sont confrontées à des disparitions touchant la biodiversité, mais aussi à l’arrivée, voire à la prolifération, de formes de vie inconnues. L’adaptation des activités humaines à cette « nouvelle nature » (Tsing et al., 2025a) est un champ d’étude foisonnant, tant pour les sciences humaines que pour les sciences de la vie. Peu de recherches ont cependant été menées à ce sujet du point de vue des faits de langage. Ce colloque, organisé à l’occasion du cinquantième anniversaire du LACITO, propose ainsi de traiter des bouleversements écologiques à partir de leurs aspects linguistiques et langagiers. D’une part, dans la mesure où ces bouleversements entraînent la disparition d’espèces animales et végétales, il est important d’évaluer la répercussion de ces pertes sur la connaissance des écosystèmes par les populations (Kik et al., 2021), notamment sur le lexique et la connaissance de la biodiversité, sur les savoir-faire et leur transmission ou encore sur les représentations et les discours liées à la faune ou à la flore. D’autre part, l’introduction de nouvelles espèces, que ce soit volontairement ou involontairement, implique l’entrée ou la création de nouveaux termes dans les langues locales, mais aussi de nouveaux usages, connaissances et représentations qui peuvent également nourrir les imaginaires. Si les mutations des environnements naturels font aujourd’hui l’objet d’une attention soutenue, on peut noter que ce ne sont pas des préoccupations nouvelles dans nos disciplines. Déjà au 19e siècle, on s’est inquiété de sauvegarder ce qui était en train de disparaître (Voir par exemple en France les travaux de grande ampleur de l’ethnologue Eugène Rolland (1967a et b) relevant faunes et flores locales avec la diversité de leurs noms, de leurs usages, des savoirs et représentations les concernant). Cependant, outre les questions de distribution des espèces, les changements dans les écosystèmes causés par l’activité humaine engendrent des trajectoires du vivant nouvelles et inattendues : proliférations, adaptations, mutations, phénomènes interspécifiques et multispécifiques... dont il est nécessaire aujourd’hui de tenir compte. Les bouleversements écologiques ont des implications sociales et culturelles, pouvant être à l’origine de migrations (Cometti, 2015 ; Stoll et Simenel, 2024), de résistance (Martin, 2016), d’adaptation (Tsing, 2017), etc. Comment cela se traduit-il dans les langues, dans les manières de parler, dans les pratiques et savoirs construits et transmis au sein des populations concernées ? On peut distinguer plusieurs cas de figure de changements écosystémiques, selon les causes ou les types de modifications. En effet, outre la modification du climat, on peut penser aux contacts induits par la colonisation, l’introduction de nouvelles cultures, ou les voyages depuis le début de la mondialisation, qui ont entraîné la circulation, voire l’invasion, multi-espèces : plantes, animaux, bactéries, virus, etc. De nombreuses espèces dites invasives empruntent les bagages de voyageurs ou accompagnent des marchandises dans les containers et se diffusent de façon incontrôlée, comme c’est le cas de nombreuses espèces d’insectes. Mais souvent, la migration de nouvelles espèces est volontaire, sans qu’on ait forcément conscience des conséquences qu’elle peut entraîner. On pense notamment aux plantes qu’on cherche à adapter ailleurs, comme ce fut le cas de la tomate, de la mangue ou encore du palmier à huile. La diffusion d’une espèce exogène peut être décidée par une autorité, comme ce fut le cas lors de l’introduction de poissons par l’autorité coloniale australienne dans les cours d’eau de Papouasie-Nouvelle Guinée pour y favoriser la pêche ; ou suivre, comme pour la pomme de terre en Europe, une longue histoire d’adoption progressive. L’introduction d’éléments étrangers à un écosystème peut être utilisée comme « arme », à l’instar des couvertures variolées offertes aux Amérindiens par exemple. Volontaires ou involontaires, toutes ces modifications peuvent avoir des conséquences importantes sur la biodiversité, à l’image du crapaud-buffle introduit en Australie par les planteurs pour lutter contre les coléoptères mais qui, du fait de leur peau venimeuse, ont décimé des populations de lézards culturellement importantes (Tsing et al., 2025a : 194-195). Les propositions de communication pourront s’inscrire dans différents axes : - Dans le contexte de la disparition d’espèces et d’écosystèmes, les témoignages collectés depuis des décennies sur le terrain par les anthropologues et les linguistes pourraient devenir les seules attestations de l’existence d’espèces disparues. Comment valoriser et faciliter l’accès à ces témoignages dans les archives ? De la même façon, pour les enquêtes de terrains menées actuellement, et alors qu’il se pourrait parfois que nous soyons les derniers témoins de réalités menacées, comment mieux documenter et préserver ce dont nous pouvons témoigner, qu’il s’agisse de données sur la faune et la flore ou de connaissances et représentations relatives à celles-ci ? Quelles nouvelles méthodes d’enquête et d’observation sont élaborées aujourd’hui pour l’étude des liens entre une population et son environnement et pour mieux documenter les terminologies complexes parfois développées pour décrire la complexité du vivant, ainsi que les savoirs relatifs à un écosystème, son usage et ses propriétés, qui sont parfois transmis dans différents genres oraux ou répertoires (contes, proverbes, chansons...) ? - Du point de vue linguistique, comment décrire les phénomènes d’attrition dus à la disparition du fait de la perte de la biodiversité ? À l’inverse, comment envisage-t-on, selon les sociétés, la nécessité de nommer de nouvelles espèces ? de nouvelles modalités d’existence ou de prolifération du vivant ? Les modifications des écosystèmes entraînent-elles des innovations lexicales (emprunts, analogies, extensions ou, au contraire, phénomènes d’attrition) ? - Du point de vue des pratiques de transmission : dans un contexte où les savoirs locaux liés à la connaissance de la flore et de la faune sont mis en danger par la disparition ou la mutation de celle-ci, comment envisager leur transmission ? Comment se transmettent et s’inventent les savoirs entre générations ou entre pairs ? - Du point de vue anthropologique, quels modes de relations entre humains et autres êtres vivants sont remis en question par ces modifications ? Comment sont-ils envisagés dans les discours, les récits d’expérience, les manières d’en parler, l’imaginaire (récits fictionnels), etc. ? - Comment, à partir de nos disciplines, envisager les impacts négatifs des bouleversements (zoonoses, champignons, algues proliférantes, virus, etc.), mais aussi les impacts positifs (nouvelles cultures par exemple) ? Comment en parle-t-on ? Perte de diversité, peur de l’invasion... ou opportunité, espoir de richesse, etc. ? - Quelles formes peuvent prendre les collaborations entre disciplines ? Si une compétence dans les sciences de la nature et des écosystèmes est utile au linguiste-anthropologue, à l’inverse « depuis au moins un siècle, l’on a enjoint symétriquement aux sciences de la Terre d’introduire des composantes sociales dans les systèmes qu’elles étudient » (Collectif Cynorhodon 2020 : XII). Les savoirs écologiques traditionnels ont des enjeux non seulement pour la description des espèces et des écosystèmes mais également pour la recherche en pharmacologie par exemple. - plus généralement, on peut s’interroger sur les modifications du rapport à l’écosystème en lien avec les changements dans les modes de vie affectant les sociétés : nouvelles mobilités ou communications numériques qui entraînent la relocalisation de communautés linguistiques dans des environnements urbains et l’éloignement de pratiques linguistiques et culturelles liées à un environnement traditionnel. Le LACITO, fondé par Jacqueline M. C. Thomas sous le parrainage scientifique d’André-Georges Haudricourt, hérite d’une longue tradition pluridisciplinaire. Plus précisément, au sein de ce laboratoire, anthropologie et linguistique ont souvent dialogué avec les sciences de la vie, en témoigne l’ouvrage publié en hommage à sa première directrice (Motte-Florac et Guarisma 2004). L’Encyclopédie aka, dont le seizième et dernier volume est paru en 2018 (Thomas et al., 1981-2018), est emblématique de l’ambition collaborative d’une recherche linguistique qui ne saurait être isolée de la vie et des préoccupations des locuteurs de la langue étudiée. À l’occasion de ce cinquantième anniversaire, cette pluridisciplinarité sera mise au service de questionnements actuels portant sur la description des savoirs et des pratiques liés à la biodiversité, dans le contexte des modifications écosystémiques subies par les sociétés humaines. Nous espérons ainsi offrir un lieu d’échange et de débat pour aider nos disciplines à affronter les nouveaux enjeux, les nouvelles questions scientifiques et les nouveaux défis posés par les transformations accélérées de nos écosystèmes. Références citées Albrecht G., 2020 [2019]. Les Émotions de la terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde, Paris, Les liens qui libèrent. Beau R. et Larrère C. (dir.), 2018. Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po. Brown R. & Evans N. (2017) “Songs that keep ancestral languages alive: A Marrku songset from western Arnhem Land”, Recirculating Songs: Revitalising the Singing Practices of Indigenous Australia, edited by J Wafer and M Turpin, 1st ed., Asia Pacific Linguistics, 287-300. Brunois-Pasina F., 2007. Le Jardin du Casoar, La forêt des Kasua. Savoir-être et savoir-faire écologiques, Paris, Éditions CNRS/MSH, Collection Chemin de l’ethnologie. Cámara-Leret, R., & Bascompte, J., 2021. Language extinction triggers the loss of unique medicinal knowledge.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(24), e2103683118. Collectif Cynorhodon, 2020. Dictionnaire critique de l’anthropocène, CNRS édition, Paris Cometti G., 2015. Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter : changement climatique et migrations chez les Q’eros des Andes péruviennes. Berne, Peter Lang, XIII-244 p. Cometti G., 2020. A Cosmopolitical Ethnography of a Changing Climate among the Q’ero of the Peruvian Andes.Anthropos, 115(1). 37-52. Crate S. A. and Nuttall M. (eds), 2016. Anthropology and Climate Change, Routledge (2nd Edition). Études rurales, 2010. Proliférantes natures, n°185. https://journals.openedition.org/etudesrurales/9014 Frye, H. & Si A., 2023. Variation in the bird-name lexicon in Qaqet (East New Britain Province, Papua New Guinea). Asia Pacific Language Variation 9(2). 240-266. Grenand F., 2008. Nommer son univers : pourquoi ? comment ? : exemples parmi des sociétés amazoniennes. In : Prat D., Raynal-Roques A. et Roguenant A. (dir.). Peut-on classer le vivant ? : Linné et la systématique aujourd’hui, Paris, Belin : 119-130. Kik, A., Adamec, M., Aikhenvald, A.Y., Bajzekova, J., Baro, N., Bowern, C., Colwell, R.K., Drozd, P., Duda, P., Ibalim, S. and Jorge, L.R., 2021. Language and ethnobiological skills decline precipitously in Papua New Guinea, the world’s most linguistically diverse nation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(22): e2100096118. doi: 10.1073/pnas.2100096118. Kumar, A., Kumar, S., Komal, Ramchiary, N., & Singh, P. (2021). Role of Traditional Ethnobotanical Knowledge and Indigenous Communities in Achieving Sustainable Development Goals. Sustainability, 13(6), 3062. Maffi, L., 2005. Linguistic, Cultural, and Biological Diversity. Annual Review of Anthropology, 34, 599–617. Martin N., 2016, Les Âmes sauvages : face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska, Paris, La Découverte. Martin N., 2022, À l’est des rêves. Réponses even aux crises systémiques, Paris, La Découverte, coll. « Les empêcheurs de penser en rond ». Minelli A., Ortalli G. & Sanga G. (eds), 2005. Animal Names, Venezia, Instituto Veneto di Scienze, Letter ed Arti. Motte-Florac E. et Guarisma G. (dir.), 2004. Du Terrain au cognitif. Linguistique, Ethnolinguistique, Ethnosciences. À Jacqueline M. C. Thomas, Paris, Peeters/ SELAF. Ortalli G. & Sanga G. (eds), 2003. Nature Knowledge. Ethnoscience, Cognition and Utility, Oxford, Bergham Books. Rolland E., 1967a. Faune populaire de la France, Paris, Maisonneuve, 13 tomes (1877-1915) ; rééd. G.-P. Maisonneuve et Larose, 13 t. en 7 vol. Rolland E., 1967b. Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore (avec Henri Gaidoz), 11 tomes (1896-1914). Reprint G.-P. Maisonneuve-Larose. Sillitoe Paul (ed.), 2021. The Anthroposcene of Weather and Climate. Ethnographic contributions to the climate change debate, Oxford, Berghahn Books and The Royal Anthropology Institute. Stoll É. et Simenel R., 2024. La Grande Migration des plantes et des humains, Delachaux & Niestlé. Stoll É. (dir.), 2025. Dossier - Migrations végétales : faire monde autrement, Revue d’ethnoécologie n°27.https://journals.openedition.org/ethnoecologie/11199 Thomas J. M. C., Bahuchet S., Epelboin A., Fürniss S. (dir.), 1981-2028, Encyclopédie des Pygmées Aka (16 volumes), Louvain, Peeters. Trisos, C.H., Auerbach, J. & Katti, 2021. M. Decoloniality and anti-oppressive practices for a more ethical ecology. Nat Ecol Evol 5: 1205–1212. https://doi.org/10.1038/s41559-021-01460-w Tsing A. L., 2017. Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Paris, les Empêcheurs de penser en rond-la Découverte. Tsing A. L. et al., 2025a. Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, Seuil (trad. fse. de 2024, Field Guide to the Patchy Anthropocene. The New Nature, Stanford University Press). Tsing A. L. et al., 2025b. Atlas Féral. Histoires vraies et proliférantes des résistances aux infrastructures humaines, Wildproject.
Modalités de soumission Les propositions de communication, en français ou en anglais, ne doivent pas excéder une page A4, à l’exclusion de matériel supplémentaire (exemple, cartes, photographie) regroupé en annexe, et sans compter la bibliographie. Les fichiers, soumis en PDF, doivent être anonymes. Pour soumettre une proposition, connectez-vous sur https://lacito50.sciencesconf.org/ et créez un compte avec “Login”. Une fois enregistré, allez sur “My Space/Mon espace”, puis sur “My Submissions”, et suivez les instructions. Les présentations dureront 20 minutes et seront suivies de 10 mn de discussion. Les résumés seront évalués en double aveugle par les membres du comité scientifique. Calendrier - Échéance pour les résumés : 30 novembre 2025 - Notification aux auteurs : 15 décembre 2025 - Échéance pour l’inscription au colloque : 28 février 2026 - Conférence : 22-24 Avril 2026
Comité d’organisation piloté par Cécile Leguy et Sylvain Loiseau San San Hnin Tun (MCF, INALCO-LACITO) Axelle Houbani (Doctorante, USN-LACITO) Mezane Konuk (Enseignante contractuelle, Université Grenoble Alpes-LACITO) Yann Le Moullec (Docteur, chercheur associé, INALCO-LACITO) Cécile Leguy (PU, USN-LACITO) Sylvain Loiseau (MCF, Paris 13-LACITO) Julie Marsault (MCF, USN-LACITO) David Low (Doctorant, USN-LACITO) Shu Takeda (Doctorant, USN-LACITO)
Comité scientifique Serge Bahuchet (DRE, MNHN-Eco-anthropologie) Isabelle Bril (DRE, CNRS-LACITO) Guillaume Jacques (DR, CNRS-CRLAO et DE EPHE) Cécile Leguy (PU, USN-LACITO) Sylvain Loiseau (MCF, Paris 13-LACITO) Émilie Mariat-Roy (MCF, Université de Tours-CITERES) Alexis Michaud (DR, CNRS-LACITO) Samia Naïm (DRE, LACITO) Aung Si (Postdoctorant, Université de Cologne) Émilie Stoll (CR, CNRS-PALOC) Nicolas Tournadre (PUE, Université d’Aix-Marseille-IUF-LACITO) Sonja Riesberg (CR, CNRS-LACITO) Martine Vanhove (DRE, CNRS-LLACAN) Conférencières et conférencier invité·es : - Aung Si, linguiste (Université de Cologne, Département de linguistique, Allemagne) - Émilie Stoll, anthropologue (CNRS - Patrimoines Locaux, Environnement et Globalisation, France) - Martine Vanhove, linguiste (CNRS – Langages, Langues et Cultures d’Afrique, France) |

